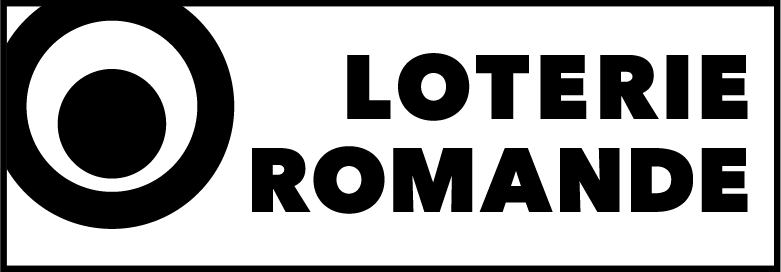Crèches et santons de Provence
Les collections du MuCEM de Marseille
Marie, Joseph, le petit Jésus, les bergers, Pistachié, l’Arlésienne, M. le Curé, Grasset et Grassette, le Ravi, le Tambourinaire, la poissonnière, les moutons et une allègre basse-cour vous invitent à un Noël méridional. Après avoir accompagné les fêtes de nombreuses familles provençales, les santons historiques du Musée des Civilisations d’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) de Marseille font une incursion en terres helvétiques pour être mis à l’honneur au Château de Gruyères.
Nées dans le sud de la France après la Révolution, les humbles figurines de terre sont dès l’origine l’expression d’une dévotion privée qui plonge joyeusement la traditionnelle scène de la Nativité dans le quotidien, avec ses personnages publics et ses scènes cocasses. A travers un choix de santons et de crèches, l’exposition dévoile ainsi un savoir-faire populaire et met en lumière les surprenantes spécificités d’une tradition séculaire.
Filipe Dos Santos et Marie Rochel
Commissaires de l'exposition
Avec la participation du MuCEM.
Vernissage
Vendredi 28 novembre, 18h
Une tradition vivante
Pour la première fois en Suisse, un grand ensemble de santons précieusement conservé par le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) de Marseille présente au public l’univers joyeux d’une longue tradition vivante.
Si toutes les crèches de Noël réunissent les mêmes personnages de base (Jésus, Marie, Joseph, l’âne et le bœuf, les Rois Mages…), chaque région a développé une production de figurines qui les composent selon des matériaux, des techniques et des styles qui leur sont propres. Parmi les productions populaires en terre cuite et peinte, on compte les santons, dans lesquels les Provençaux ont insufflé une âme teintée de générosité et d’espièglerie.
Puisant ses racines dans les traditions antiques et médiévales, la production de santons s’est développée au Sud de la France peu après la Révolution française. Avec la fermeture des lieux de culte et le mouvement de déchristianisation, les familles provençales ont «déplacé» dans leurs intérieurs, mais dans de plus petites dimensions, les crèches publiques de l’Eglise. Usant de matériaux disponibles localement (l’argile), les santonniers ont alors reconstitué la scène de la Nativité et l’ont agrémenté en puisant dans l’imagier régional.
Plongés dans le cadre d’un village typique, les acteurs de ces crèches sont à la fois les personnages bibliques et l’ensemble de la société provençale avec ses personnalités : le pécheur, la lavandière, le berger, le marchand d’ail… A l’occasion de la Nativité, tous ces personnages deviennent des petits saints (des «santons») et chacun trouve sa place dans ce théâtre entre religieux et civil, y compris le Ravi, « simple de cœur » aux bras toujours levés de réjouissance, ou Pistachié, valet de ferme polisson. D’autres personnages traditionnels ont une histoire plus personnelle comme l’homme devenu aveugle après avoir pleuré l’enlèvement de son fils ainé ; guidé par son cadet, il rejoint la crèche en faisant le vœu, qui sera exaucé, du retour de son enfant.
Artisans d’une tradition en constante évolution, les santonniers n’ont eu cesse à travers le temps d’offrir des nouveautés. A son paroxysme, la crèche se mue alors en diorama représentant un village entier avec des santons anachroniques et truculents comme le chasseur équipé de son fusil, le ramoneur ou le maire – écharpe bleu-blanc-rouge en ceinture –, qui se rend à la crèche pour inscrire le petit Jésus à l’état civil.
L’exposition a bénéficié du précieux soutien du MuCEM, premier grand musée national français consacré aux civilisations d’Europe et de la Méditerranée qui a ouvert ses portes à Marseille en 2013. L’accès à leurs collections permet de montrer à Gruyères, non seulement la richesse d’une tradition et ses spécificités, mais elle révèle également un langage artisanal varié, dans lequel chaque santonnier décline son accent.